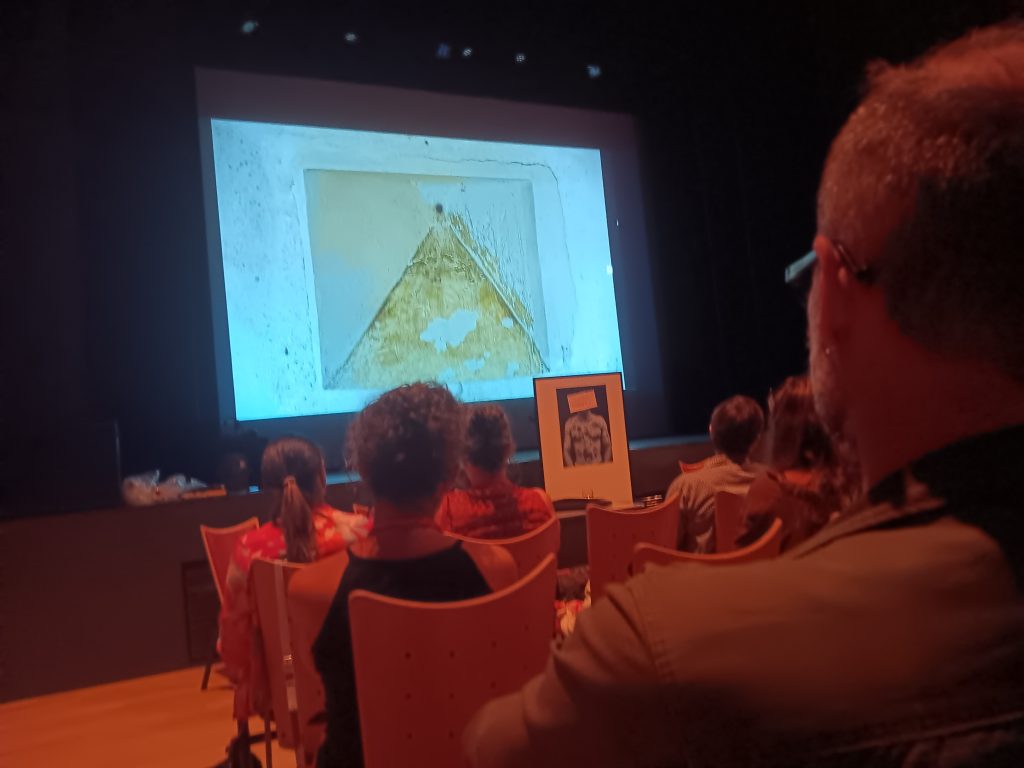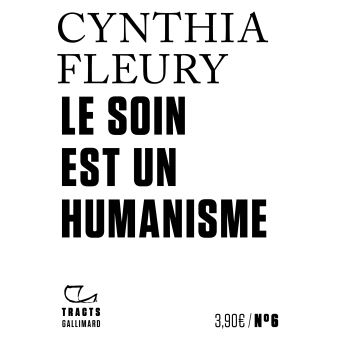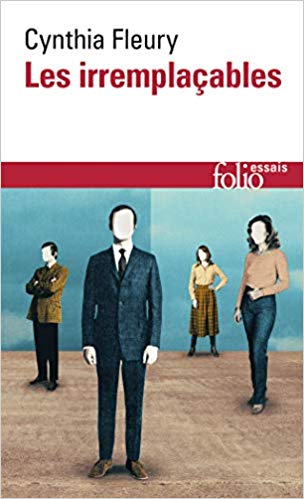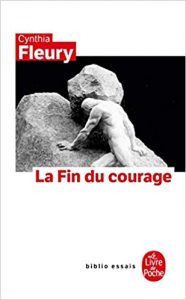Au service de l’accompagnement spirituel de la personne hospitalisée
Le 18 novembre 2024, le Comité exécutif de la Fondation a décerné ses prix de mémoire 2024. Parmi eux, le travail de Madame Blandine Vrel, aumônier catholique au Centre Hospitalier Lyon-Sud depuis 2021, présenté dans le cadre du DU « Religion, liberté religieuse et laïcité » 2022-2023. Il portait sur : « Soigner et cultiver le partenariat aumôniers-soignants au service de l’accompagnement spirituel de la personne hospitalisée ». Elle nous le présente en quelques lignes.
La finitude, la souffrance, la maladie et la mort s’expriment profondément à l’hôpital. La médecine veille sur l’homme là où son humanité est la plus exposée dans la fragilité et c’est pourquoi une place singulière de veille lui est assignée. La place de l’accompagnement spirituel en milieu de santé se pense dans un contexte de sécularisation des institutions de soins et de la société, mais aussi de prise en compte de la personne dans toutes ses dimensions par les soins. À l’heure où les prises en charge se veulent globales, il est donc nécessaire pour l’entourage de la personne hospitalisée, médical ou non, d’intégrer cette dimension spirituelle. J’ai choisi de m’interroger sur cette mission de l’aumônier : collaborer avec les soignants pour apporter plus d’humanité au sein des hôpitaux et incorporer une certaine éthique dans la prise en charge globale des personnes hospitalisées en prenant en compte les particularités cultuelles et culturelles des personnes. Plusieurs enjeux éthiques ont guidé et éclairé ma recherche.
Le patient comme personne
La maladie demeure une expérience, un ébranlement, un événement destructeur et/ou fondateur. Sous-jacente à la question de l’identité se joue la question de la permanence de soi. « Je suis un fardeau », « Pourquoi vous perdez votre temps avec moi », « Je sers plus à rien », « Je ne me reconnais même plus ». Comment percevoir la dignité des personnes malgré toutes les défigurations de la maladie, du vieillissement, du handicap… ? Comment répondre de manière ajustée à la vulnérabilité de l’autre en prenant en compte sa subjectivité (soigner mais pas malgré l’autre) ?
La spiritualité
L’OMS inclut la spiritualité dans sa définition de la santé, en caractérisant l’humain par quatre dimensions : biologique, psychologique, sociale et spirituelle. Qu’est-ce qui me fonde en tant qu’être humain ? Qu’est-ce qui donne sens à ce que je vis ? Au cœur de ces interrogations, les personnes accueillies à l’hôpital doivent pouvoir faire entendre leur questionnement spirituel ou religieux. C’est une nouvelle perspective de l’accompagnement aux soins qui s’ouvre en permettant aux aumôniers et aux soignants d’offrir leurs compétences respectives. De quoi faut-il prendre soin en tout être humain : cohérence, transcendance, unité…? Comment soutenir la personne hospitalisée mais vivante jusqu’au bout, jusque dans la dépendance, la souffrance ?
L’alliance thérapeutique
La maladie altère la relation. C’est une sorte de mort sociale, relationnelle. Cependant, la personne hospitalisée est de plus en plus sujet, acteur de ses soins et non plus passif, ce qui peut complexifier la tâche des soignants mais aussi l’humaniser voire la faciliter en acceptant la personne hospitalisée dans sa globalité. Il s’agit de « créer une alliance ». La religion est une pierre participant à la construction de cette alliance thérapeutique dans le quotidien des soins. Sa prise en compte est le meilleur garant du respect de ce qu’est chacun. Ce travail en alliance peut viser la réunification de la personne, dans toutes ses dimensions, et lui permettre d’être « sujet de sa propre histoire. Comment développer une attention au vécu de l’autre pour le soigner le mieux possible ?
A chacun à sa place
Comment évaluer les besoins spirituels, détecter les demandes ? Comment les soignants, tout en respectant les exigences de la laïcité (ils sont tenus au principe de neutralité), peuvent-ils être attentifs à ces « besoins spirituels » et aux « besoins religieux », notamment cultuels, pour accompagner au mieux les personnes accueillies ? Quelle coordination mettre en place avec les équipes pour répondre au désir d’accompagnement de la personne ?
Quid de la place des autres religions ?
Les soignants ne souffrent pas seulement de la mort qui demeure la limite de toutes leurs pratiques et réussites mais de la déshumanisation de la mort lorsqu’elle est privée d’accompagnement et de ritualisation (Cf. la pandémie du COVID). A l’hôpital, la religion peut être une ressource face à la maladie, un lieu de soin : elle participe à l’équilibre fondamental de celui qui croit. Une question peut être soulevée, celle de la présence majoritaire des aumôniers de religion catholique. Un des enjeux est de respecter un pluralisme, essentiel à la laïcité, et une équité dans la place des différentes religions. Nos manières de pratiquer et vivre notre foi sont différentes. Comment prendre en compte les aumôneries protestantes, juives, musulmanes ? Pourrait-on imaginer que la visite de présentation se fasse au nom de toutes les aumôneries ? Cette présence dominante peut-elle être perçue comme une forme de prosélytisme ?
Y a-t-il un risque d’appropriation médicale de la spiritualité ?
L’expérience spirituelle risque d’être médicalisée, réduite à des fins thérapeutiques. Si le seul but du spiritual care est la diminution et même l’élimination de toutes les souffrances, l’organisme devrait être sans faille, harmonieux, parfait. Guy Jobin évoque « l’esthétisation biomédicale de la spiritualité ». Cependant, nous le constatons, l’expérience de la maladie reste un combat, une lutte. Comment le spirituel peut-il rester ce qui échappe à toute récupération parce qu’il concerne la gratuité, l’identité profonde, le mystère et la liberté de la personne ? Comment préserver la spiritualité de l’utilitaire, du mesurable et du consommable ?
Un autre défi est de préserver la confidentialité et la liberté des personnes hospitalisées. Qu’en est-il du secret médical si le professionnel du spiritual care doit faire un compte-rendu systématique de ses visites à l’équipe soignante ? La confusion entre soignants médicaux et accompagnateurs spirituels pourrait être néfaste à la confiance établie. Pour préserver la gratuité du spirituel hors de toute récupération, nous devons veiller à ne pas être utilisés et à sortir d’une logique de l’efficacité et de l’utilité. De fait, il semble essentiel de considérer la personne comme un mystère et d’accepter que le « soin spirituel » demeure invisible et pas réduit à un modèle ou à une recette. Un des défis de l’aumônerie est donc de promouvoir l’intégration des ressources spirituelles et religieuses dans le soin mais sans laisser la médecine réduire et instrumentaliser ces ressources ou quantifier le soin spirituel.
Il nous faut également être vigilants quant au prosélytisme vis-à-vis des personnes vulnérables. Dieu n’entre jamais dans la vie de quelqu’un par effraction. S’interroger ensemble sur « ce que dit la loi » permet d’apaiser les débats et de créer un espace de parole. Il devient possible de parler de religion sans laisser planer la crainte d’une emprise religieuse menaçant les libertés en contexte de vulnérabilité. La laïcité permet de rappeler les droits en fixant des limites.
Prendre soin : une vocation pour tous
La pandémie a pu être une révélation de la place du soin dans notre vie et dans la société. Cette nouvelle conscience du soin ravive la pertinence des éthiques du care et des politiques du care.
Les actes spirituels soutiennent nos manières de “vivre bien” et, inspirés par les héritages des traditions spirituelles et religieuses, permettent de prendre soin de soi, des autres et du monde : cultiver l’intériorité, stimuler la quête de sens et la formulation des valeurs personnelles, examiner et choisir ce qui convient davantage, attester de la dignité de tout être humain en écoutant la convocation à prendre soin d’autrui, élaborer inlassablement, dans l’entretien mutuel et collectif, le monde commun.
Selon cette philosophie, le care n’est plus une aptitude censée caractériser une prétendue nature féminine plus attentive à la vie et aux personnes mais une exigence démocratique et universaliste. Prendre soin n’est plus une vocation pour quelques-uns, il est une convocation adressée à tous. C’est la société plus largement qui bénéficie de cette restauration, si on donne une définition large du soin dont la finalité est de vivre bien. Prendre soin de l’autre, c’est participer à « maintenir, perpétuer et réparer notre monde ». Comment la promotion de la santé spirituelle doit s’inscrire dans l’action publique avec un souci éthique et une visée morale, à l’endroit de l’ensemble de la communauté humaine ?
L’aumônerie en milieu hospitalier public est une illustration de la laïcité au service de l’intégrité et l’autonomie de la personne. L’assistance spirituelle est donc un service public. La dimension religieuse ou spirituelle étant une composante de l’Homme, notre mission d’aumônier participe ainsi au soin de la personne hospitalisée. C’est pourquoi il nous semble nécessaire d’encourager les soignants à être nos partenaires pour une prise en charge de la personne dans sa globalité et son intégrité : comment bénéficier de la façon la plus juste de leur investissement ?